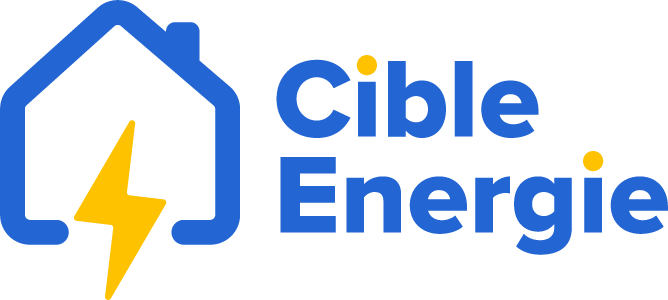L’humidité dans les murs d’une maison ancienne est un fléau qui touche de nombreux propriétaires. Selon l’Insee, près de 20 % des logements en France sont concernés par des problèmes d’humidité. Ce chiffre, souligne une problématique persistante, particulièrement dans le bâti ancien.
Loin d’être une simple nuisance esthétique, l’humidité excessive peut dégrader la structure même de votre habitation et avoir des répercussions négatives sur la santé de ses occupants. Des taches disgracieuses aux odeurs de moisi, en passant par le décollement des revêtements, les signes ne trompent pas. Il est donc crucial de comprendre les origines de cette humidité pour y apporter des solutions durables et retrouver un intérieur sain et confortable. Cet article vous guide à travers les causes spécifiques et les traitements adaptés.
Pourquoi les maisons anciennes sont-elles sensibles à l’humidité ?
Les maisons anciennes, avec leur charme et leur histoire, possèdent des caractéristiques architecturales et des matériaux qui les rendent intrinsèquement plus vulnérables à l’humidité que les constructions modernes. Plusieurs facteurs expliquent cette sensibilité accrue. Plusieurs facteurs expliquent cette sensibilité accrue.
Tout d’abord, les matériaux de construction utilisés autrefois, tels que la pierre, la brique pleine ou le pisé, sont souvent poreux et plus perméables à l’eau. Contrairement aux matériaux contemporains dotés de barrières anti-humidité intégrées, ces matériaux ancestraux ont tendance à absorber l’eau du sol ou de l’air ambiant.
Par ailleurs, un phénomène fréquent dans ce type de bâti est celui des remontées capillaires. L’eau présente dans le sol monte naturellement à travers les pores des matériaux par un effet de capillarité. Ce problème affecte surtout les maisons dépourvues d’une arase étanche à la base des murs, une technique de construction qui n’était pas systématiquement mise en œuvre par le passé. L’eau du sol, chargée en sels minéraux, migre ainsi vers le haut, provoquant des dégradations visibles telles que des taches d’humidité, l’effritement des enduits ou l’apparition de salpêtre.
En ce qui concerne les maisons des années 70, bien que plus récentes que des bâtisses séculaires, elles peuvent aussi présenter des taux d’humidité élevés. À cette époque, les premières réglementations thermiques commençaient à apparaître, mais l’accent était davantage mis sur l’isolation que sur la ventilation. Ce défaut de renouvellement de l’air intérieur favorise la condensation.
En outre, l’âge même de la structure joue un rôle. Les systèmes de plomberie ou de couverture peuvent vieillir et présenter des fuites insidieuses qui, sur le long terme, saturent les murs en eau.
Comment identifier la source de l’humidité ?
Déterminer l’origine de l’humidité est l’étape la plus cruciale avant d’envisager tout traitement. Un mauvais diagnostic peut conduire à des travaux inefficaces et coûteux. Plusieurs indices et méthodes peuvent vous aider.
L’observation visuelle est le premier réflexe. Recherchez les signes caractéristiques :
- Tâches d’humidité : Leur forme, leur localisation (bas de mur, angles, autour des fenêtres) et leur évolution sont des indicateurs précieux. Des taches en bas des murs, progressant vers le haut, suggèrent des remontées capillaires. En revanche, des traces isolées en hauteur ou sur les plafonds peuvent indiquer une infiltration ou une fuite.
- Moisissures : La présence de taches noires, verdâtres ou blanchâtres, souvent accompagnées d’une odeur de vieux ou de moisi, signale une humidité excessive et une mauvaise ventilation. Elles se développent fréquemment dans les angles, derrière les meubles ou dans les pièces d’eau.
- Salpêtre et efflorescences : Ces dépôts blanchâtres et poudreux à la surface des murs sont typiques des remontées capillaires, résultant de la cristallisation des sels minéraux transportés par l’eau.
- Dégradation des revêtements : Le papier peint qui se décolle, la peinture qui cloque ou s’écaille, les enduits qui gonflent ou se désagrègent sont des conséquences directes de la présence d’eau dans les murs.
- Condensation : La formation de buée sur les vitres ou les surfaces froides indique un air intérieur saturé en humidité et/ou des parois trop froides, souvent lié à un défaut de ventilation ou d’isolation.
Les odeurs sont également un bon indicateur. Une odeur persistante de moisi, de renfermé ou de terre humide est un signe qui ne trompe pas.
Pour affiner le diagnostic, l’utilisation d’appareils de mesure peut s’avérer utile. Un hygromètre permet de mesurer le taux d’humidité relative de l’air ambiant, tandis qu’un humidimètre de contact (ou testeur d’humidité pour matériaux) évalue la teneur en eau directement dans les murs. Ces mesures, comparées aux valeurs de référence, donnent une indication quantitative du problème.
Comment traiter l’humidité dans les murs d’une maison ancienne ?

Une fois la source de l’humidité clairement identifiée, différentes solutions peuvent être envisagées. Le choix du traitement dépendra directement de la cause du problème. Il est souvent nécessaire de combiner plusieurs actions pour un résultat optimal et durable.
Si le problème provient d’une ventilation insuffisante conduisant à de la condensation, la solution principale est d’améliorer le renouvellement de l’air. L’installation d’une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC), simple flux hygroréglable (qui adapte son débit en fonction du taux d’humidité) ou double flux (qui récupère la chaleur de l’air extrait), est souvent la mesure la plus efficace. Aérer quotidiennement toutes les pièces pendant au moins 10-15 minutes, même en hiver, reste un geste complémentaire indispensable.
Contre les remontées capillaires, plusieurs techniques existent :
- L’injection de résine hydrophobe : Des trous sont percés à la base du mur affecté, et une résine est injectée pour créer une barrière étanche qui bloque la montée de l’eau.
- L’électro-osmose (ou assèchement électronique) : Des électrodes sont placées dans le mur pour inverser le champ électrique responsable de la migration de l’eau, la repoussant ainsi vers le sol.
- Le drainage périphérique : Si l’humidité provient d’une saturation en eau du sol autour des fondations, la pose d’un drain à l’extérieur, le long des murs enterrés, peut aider à collecter et évacuer cet excès d’eau. Cela est particulièrement pertinent pour les murs de soubassement.
En cas d’infiltrations d’eau de pluie par la façade ou la toiture, il est impératif de réparer les fissures présentes sur les murs extérieurs à l’aide d’enduits adaptés. Il est également conseillé d’appliquer un traitement hydrofuge afin de rendre la façade imperméable à l’eau tout en la laissant respirer. Par ailleurs, l’état de la toiture, des gouttières et des descentes d’eaux pluviales doit être vérifié et, si nécessaire, réparé pour s’assurer qu’ils ne sont pas à l’origine des infiltrations.
Pour les murs enterrés (caves, sous-sols) sujets à la pression hydrostatique, un cuvelage peut être nécessaire. Cette technique consiste à appliquer un revêtement étanche à l’intérieur des murs et sur le sol pour créer une sorte de caisson imperméable.
Enfin, il est essentiel de supprimer les revêtements non respirants (certains enduits ciment, peintures plastifiées) qui peuvent emprisonner l’humidité dans les murs anciens et d’opter pour des matériaux perspirants (enduits à la chaux, peintures minérales) qui permettent aux murs de « respirer » et de réguler naturellement leur hygrométrie.
Comment isoler un mur humide d’une maison ancienne ?
Isoler un mur humide sans avoir traité la cause de l’humidité au préalable est une erreur majeure. Cela risque d’emprisonner l’humidité, d’aggraver les dégradations à l’intérieur du mur, de rendre l’isolant inefficace et de favoriser le développement de moisissures entre le mur et l’isolant.
La première étape impérative est donc d’assainir le mur. Une fois le mur asséché et la source d’humidité traitée, vous pouvez envisager son isolation. Pour les maisons anciennes, il est crucial de choisir des techniques et des matériaux d’isolation compatibles avec la nature du bâti et la gestion de l’humidité résiduelle ou potentielle.
Isolation des murs par l'intérieur
Pour l’isolation des murs par l’intérieur (ITI), technique la plus couramment utilisée en rénovation, plusieurs options peuvent être envisagées. Il est notamment possible de créer une lame d’air ventilée en laissant quelques centimètres entre le mur assaini et le nouvel isolant. Cette lame d’air, idéalement ventilée vers l’extérieur ou via un système mécanique, facilite l’humidité qui pourrait encore s’y trouver.
Une autre solution consiste à utiliser des isolants à la fois résistants à l’humidité et perspirants. Certains matériaux sont plus adaptés que d’autres en présence d’une humidité résiduelle ou pour des murs qui ont besoin de respirer.
- Le liège expansé est un excellent choix. Il est imputrescible, résistant à l’humidité, perspirant (perméable à la vapeur d’eau) et offre de bonnes performances thermiques et acoustiques.
- Les panneaux de fibres de bois denses traités hydrofuges peuvent aussi convenir, car ils ont une bonne capacité à réguler l’hygrométrie.
- Le verre cellulaire est totalement étanche à l’eau et à la vapeur, ce qui peut être un avantage dans certains cas très spécifiques de murs enterrés, mais il empêche toute respiration du mur
- Certains isolants synthétiques comme le polystyrène extrudé (XPS) sont très peu sensibles à l’eau. Toutefois, leur étanchéité à la vapeur d’eau peut poser problème lorsque le mur a besoin de sécher vers l’intérieur.
L’utilisation d’un frein-vapeur hygrovariable côté intérieur (côté chaud) est souvent recommandée. Contrairement à un pare-vapeur classique (totalement étanche), le frein-vapeur hygrovariable adapte sa perméabilité à la vapeur d’eau en fonction de l’humidité ambiante, permettant au mur de sécher vers l’intérieur en été tout en limitant la pénétration de vapeur d’eau en hiver.
Isolation par l'extérieur
L’isolation par l’extérieur (ITE) peut également être une solution très performante, car elle traite l’ensemble de l’enveloppe et supprime la plupart des ponts thermiques. Cependant, elle modifie l’aspect extérieur de la maison, ce qui peut être une contrainte pour les bâtisses de caractère. Si cette option est choisie, il faudra également veiller à utiliser des systèmes d’ITE perspirants.
Consulter un professionnel qualifié est indispensable pour choisir la solution d’isolation la plus adaptée à votre mur humide, garantissant à la fois performance thermique et pérennité de la structure. En traitant l’humidité à sa source et en choisissant les bonnes techniques, vous transformerez votre maison ancienne en un lieu de vie sain, confortable et économe en énergie.